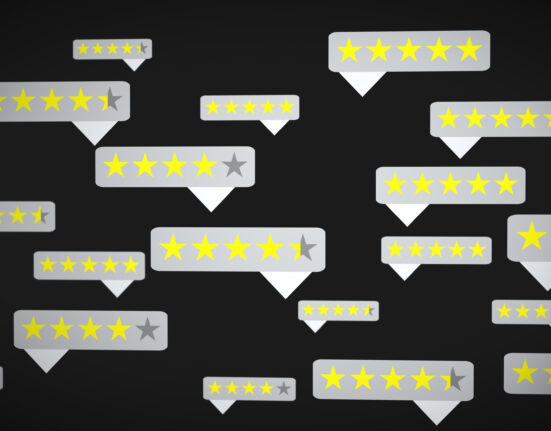Olivier Guyottot, enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques à l’INSEEC Grande École, est spécialisé dans l’étude de l’enseignement supérieur et des Grandes Écoles de Management françaises (aussi appelées « Business Schools »). Il possède un master Grande École en management de Kedge BS et un doctorat en sciences politiques de l’université d’Aston (Angleterre) et a occupé plusieurs postes de direction dans des écoles et des universités françaises et étrangères. Pour Business Cool, il met en lumière les thèmes qu’il étudie dans le cadre de ses recherches pour vous aider à mieux comprendre le « dessous des cartes » de l’enseignement supérieur et des Grandes Écoles de Management.
Le recrutement étudiant est un enjeu stratégique pour les Grandes Écoles de Management (ou « Business Schools ») françaises. Il constitue en effet leur principale source de revenus pour financer leur développement et rivaliser avec les meilleures institutions internationales. Il influence aussi fortement leur capacité à mener avec succès leur mission éducative d’intérêt général et à s’ouvrir à des publics plus diversifiés.
Depuis de nombreuses années, les Grandes Écoles de Management ont mis en place des stratégies de coopétition consistant à coopérer et à s’allier entre écoles concurrentes pour réussir cette phase si cruciale. Mais si cette coopération entre organisations rivales semble plébiscitée par les instances académiques et les écoles elles-mêmes, force est de constater que plusieurs d’entre elles préfèrent agir de manière indépendante pour le recrutement de certaines voies d’entrée ou de certains programmes. C’est le cas depuis de nombreuses années pour les concours d’admission sur titre de la majorité des Programmes Grande École du top 10. Ce sera le cas cette année des BBA d’Excelia et de South Champagne Business School (SCBS), qui viennent de sortir de Sésame, pourtant considéré comme le concours commun de référence pour les PGE post-bac et les BBA.
Comment expliquer ce décalage ? Quel est réellement l’impact des stratégies de coopétition sur le fonctionnement et la performance des écoles, ainsi que sur la réussite des candidats ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons mené un projet de recherche (Guyottot et al., 2025) et interrogé 36 personnes en lien avec la mise en place de ces stratégies : 6 directeurs de « banques de concours », 7 directeurs d’école ou de programme, 6 directeurs des admissions, 5 représentants d’organismes institutionnels en charge du fonctionnement de l’écosystème des écoles, 6 candidats ou étudiants et 6 enseignants spécialisés dans la préparation à ces concours.
La coopétition : coopérer avec ses concurrents
Contraction des termes coopération et compétition, la coopétition peut être définie comme « une relation dynamique et paradoxale qui se produit lorsque deux entreprises coopèrent dans certains domaines (comme les alliances stratégiques), tout en étant simultanément en concurrence dans d’autres domaines » (Bengtsson et Kock, 2000, p. 411).
C’est une stratégie qui peut sembler contre-intuitive, alors que le système dans lequel nous vivons promeut la compétition pour réussir. C’est pourtant une stratégie qui s’est fortement développée ces quarante dernières années, car la coopétition offre de nombreux avantages : elle permet par exemple de mutualiser des expertises complémentaires, de financer des projets trop coûteux ou de mettre en place des référentiels communs. Elle n’est toutefois pas sans risque, et beaucoup d’organisations s’en méfient, craignant notamment de se faire copier par leurs concurrents lors de cette phase de coopération et de se retrouver distancées lorsque la compétition reprendra son cours normal. La coopétition constitue donc un vrai défi organisationnel et managérial pour les organisations souhaitant mettre en place ce type de stratégie (Le Roy et al., 2016).
La coopétition entre Grandes Écoles de Management pour le recrutement étudiant
La coopétition est une stratégie assez courante dans l’enseignement supérieur (doubles diplômes ou joint degrees, projets de recherche communs, promotion — en particulier à l’international —, etc.), et les concours communs qu’organisent les Grandes Écoles de Management françaises pour le recrutement de leurs étudiants en sont une illustration (BCE, Ecricome, Passerelle, Accès, Sésame…). Les écoles collaborent pour promouvoir et organiser un concours élaboré et mis en place conjointement… mais redeviennent concurrentes lors de l’affectation des étudiants, en tentant d’attirer les meilleurs éléments.
Grâce aux stratégies de coopétition, les écoles appartiennent à un « cercle fermé » fondé sur la légitimité académique, les valeurs partagées et les histoires communes entre organisations et dirigeants. L’expertise organisationnelle et réglementaire des banques de concours communs tend à garantir la transparence, la sécurité et la crédibilité de leur processus de recrutement étudiant. Cette alliance permet aux écoles les moins prestigieuses de profiter de l’image et de la réputation des écoles leaders, et aux candidats de découvrir de nouvelles écoles tout en optimisant le nombre d’écoles présentées et l’organisation logistique de leurs concours. La coopétition permet aussi aux écoles de maximiser l’utilisation de leurs ressources en matière de promotion et de communication, générant ainsi un volume de candidats souvent largement supérieur à celui d’un concours indépendant.
Mais cette augmentation du nombre de candidats, qui pourrait laisser supposer une plus grande ouverture et devrait théoriquement profiter à toutes les écoles, semble avoir une influence limitée sur la diversité des profils recrutés par l’ensemble d’entre elles et sur le taux de remplissage des moins bien classées. Une situation qui interroge la pertinence de ce type de stratégie.
Concurrence positionnelle, légitimité, réputation et soft power
Dans le cas des concours post-prépa, même si certaines écoles peinent à atteindre leurs objectifs de recrutement, la question de la participation au système coopétitif ne se pose pas, car la coopétition va de pair avec un continuum qui assure cohérence et visibilité à l’ensemble de la filière (classes préparatoires, écoles et étudiants). D’un côté, les écoles profitent d’un marché captif dans la mesure où les élèves se destinent, à quelques exceptions près, à intégrer une école. De l’autre, les candidats sont assurés d’intégrer un programme délivrant un grade de master, alors qu’il reste difficile, pour les non-initiés, de distinguer les formations diplômantes des formations non reconnues. La coopétition est un passage obligé pour les écoles, et en sortir signifie tourner le dos à cette voie d’entrée.
Dans les autres cas, la question se révèle pertinente. Dans un environnement où il demeure difficile de se distinguer sans mettre en danger la pérennité économique et la réputation de son institution, la coopétition peut apparaître comme un moyen d’éloigner de potentiels nouveaux entrants grâce à une concurrence dite « positionnelle » (en référence à un marché où les entrées et les sorties sont quasiment inexistantes et où seule la hiérarchie des institutions peut évoluer ; Menger et al., 2015). Elle est aussi perçue comme un moyen de renforcer la réputation académique et la légitimité externe et interne (Drori & Honig, 2013) ainsi qu’institutionnelle (Misra & Stensaker, 2024) grâce à des processus de sélection sécurisés et reconnus. Enfin, elle apparaît, pour les écoles impliquées dans les gouvernances de ces structures, comme un potentiel outil de soft power (Gautam et al., 2024) à l’échelle nationale, agissant en complément d’actions plus classiques de développement (recherche, accréditations, partenariats, nouveaux campus, etc.).
La nécessité de règles et d’une gouvernance assurant l’optimisation quantitative et qualitative du recrutement
L’approche des stratégies coopétitives des écoles est aujourd’hui fortement impactée par la baisse du nombre de bacheliers et d’étudiants qui s’annonce dans les prochaines années. Celle-ci renforce la tendance des écoles à croitre et à rechercher une taille critique pour survivre et se développer et modifie les rapports de force et les relations de pouvoir de ce type d’alliance.
L’efficacité des stratégies de coopétition peut logiquement varier en fonction de la notoriété de chaque école. Mais les règles (inscription groupée ou par école, régulation du nombre de places ouvertes, règles d’affectation…) et la gouvernance de chaque banque de concours influencent aussi fortement l’optimisation du recrutement des écoles. Alors que le nombre élevé de candidats et de candidatures associé à la coopétition favorise la sélectivité des écoles leaders, en orientant vers elles des élèves qui se seraient sans doute autocensurés (Hong & Stüttgen, 2023), il génère aussi des « faux candidats » pour les écoles les moins prestigieuses (c’est-à-dire des candidats qui n’ont jamais envisagé d’intégrer ces écoles, quels que soient leurs résultats), gonflant artificiellement leurs candidatures et rendant leur recrutement d’autant plus périlleux, malgré son importance.
En standardisant et en uniformisant les attendus et critères d’admission, les stratégies de coopétition rendent aussi plus difficile la détection des profils atypiques, qui peinent, sauf exception, à se distinguer. La coopétition ne modifie qu’à la marge des affectations fondées principalement sur les compétences académiques (Santelices et al., 2022), et tend à avantager les candidats les plus aguerris au fonctionnement et aux règles de l’enseignement supérieur. Ce que les écoles parviennent cependant à corriger en partie grâce à l’utilisation croissante d’épreuves sollicitant des compétences dépassant le seul bagage scolaire traditionnel, comme les entretiens de motivation.
Finalement, si la coopétition pour recruter des étudiants offre des avantages certains, notre projet de recherche montre qu’il est cependant essentiel, pour les écoles qui souhaitent l’adopter, de voir plus loin que la simple augmentation du nombre de candidatures. Il s’agit notamment de vérifier que les règles de fonctionnement et de gouvernance assurent à chacune d’elles l’optimisation à la fois quantitative et qualitative de leur recrutement et de permettre ainsi à ces stratégies d’alliance si particulières de donner lieu à une relation gagnant-gagnant (Peng et al., 2012) pour les écoles et les candidats.
Annexes : références
Bengtsson, M., and S. Kock. 2000. “‘Coopetition’ in Business Networks—To Cooperate and Compete Simultaneously.” Industrial Marketing Management 29, no. 5: 411–426.
Drori, I., and B. Honig. 2013. “A Process Model of Internal and External Legitimacy.” Organization Studies 34, no. 3: 345–376.
Gautam, P., B. Singh, S. Singh, S. L. Bika, and R. P. Tiwari. 2024. “Education as a Soft Power Resource: A Systematic Review.” Heliyon 10: e23736.
Hong, S., and P. Stüttgen. 2023. “Reach Up, Fit in, or Stand Out? The Evaluation of Academic Quality and Fit in College Choices.” Studies in Higher Education 48, no. 9: 1333–1345.
Le Roy, F., M. Robert, and F. Lasch. 2016. “Choosing the Best Partner for Product Innovation.” International Studies of Management and Organization 46, no. 2–3: 136–158.
Menger, P. M., C. Marchika, and D. Hanet. 2015. “Positional Competition in Higher Education. Business Schools and Their Academic Turn in France.” Revue économique 66, no. 1: 237–288.
Misra, D., and B. Stensaker. 2024. “Balancing Control and Legitimacy in Higher Education Policy Implementation.” Studies in Higher Education. Published online: 24 Jan 2024, 1–14.
Peng, T. J. A., S. Pike, J. C. H. Yang, and G. Roos. 2012. “Is Cooperation With Competitors a Good Idea? An Example in Practice.” British Journal of Management 23, no. 4: 532–560.
Santelices, M. V., C. Horn, X. Catalán, and A. Venegas. 2022. “Aggregated Results of Access Programs Implemented by Universities in Chile: Students’ Persistence Using a Matched Sample.” Higher Education Policy 35, no. 5: 1–24.
Guyottot, O., Couston, A., & Tran, S. (2025). The Impact of Coopetition on Student Recruitment in Higher Education: A Study of French Business Schools’ Admission Strategy. Higher Education Quarterly, 79(1), e12587.